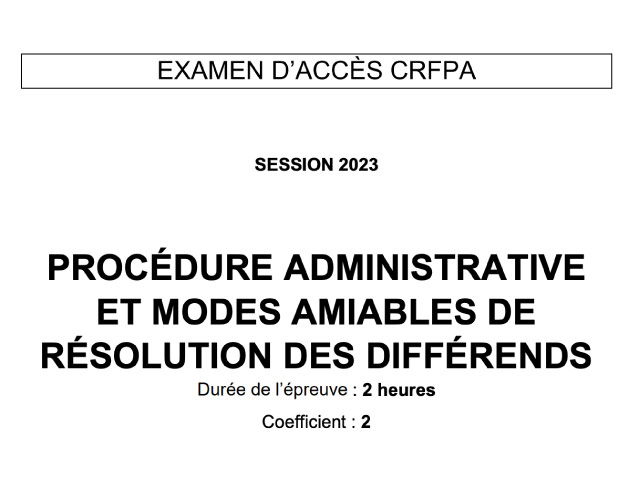Question 1 :
Mr Landrin est le propriétaire d’un terrain en friche. La commune avait aménagé sur ce terrain un parking public et des espaces verts sans son consentement. Par voie de conséquence, Mr Landrin s’est insurgé contre cette mesure et revendique à présent la remise en état de ce terrain et l’indemnisation des préjudices subis. Cette situation met en lumière le fait de porter atteinte à une propriété privée. Pour affronter cette adversité, Mr Landrin s’interroge sur le juge qui est compétent pour ce recours.
Il est pertinent de rappeler que le choix du juge est fondé sur la détermination de la nature de l’acte adopté par la commune : s’agit-il d’une voie de fait ou d’une emprise ?
En vertu de la décision du Tribunal des conflits, 2013, M. Bergoend c/ ERDF Annecy Léman : « il n’y a voie de fait de la part de l’administration que dans deux hypothèses : lorsqu’elle a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ; et lorsqu’elle a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. » * Cela met en évidence les conditions nécessaires pour juger une action administrative comme une voie de fait. Cette dernière se manifeste lorsque l’administration commet une action grave et illégale, portant ainsi sérieusement atteinte à la liberté individuelle ou la propriété des personnes, soit en forçant l’exécution d’une décision inappropriée, soit en adoptant une décision arbitraire et illégitime. Cela aboutit à « l’extinction d’un droit de propriété » ou à « une atteinte à la liberté individuelle ».
Selon la décision du Tribunal des conflits, 2013, Epoux Panizzon c/ Commune de Saint-Palais-sur-Mer : « Sur le plan procédural, il est jugé que la simple production d’une transaction conclue sous condition ne suffit pas à priver d’objet la question de compétence renvoyée au Tribunal des conflits dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalisation de la condition et, partant, du désistement effectif du demandeur. Quant à la question de compétence, dans la logique de sa décision redéfinissant la voie de fait et aussi dans le souci d’une bonne administration de la justice, le Tribunal considère que, dans la mesure où seule la dépossession définitive donne compétence au juge judiciaire pour réparer le préjudice résultant d’une telle dépossession, l’atteinte au droit de propriété caractérisée soit par une dépossession temporaire soit par une altération ponctuelle de ses attributs ne peut faire échec au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, en sorte que le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d’indemnisation du préjudice né d’une emprise irrégulière » * Cette décision éclaircit le fait que l’intervention du juge judiciaire n’est envisageable que lorsque la perte de propriété est complète et définitive. Si ce n’est pas le cas, c’est le juge administratif qui est compétent et en mesure de mettre fin aux litiges.
Comme on l’a souligné auparavant, la voie de fait se limite aux cas où il y a une véritable extinction au droit de propriété. En l’espèce, on ne peut pas considérer qu’il s’agit d’une telle extinction. En guise de conclusion, on n’est pas en présence d’une voie de fait mais plutôt d’une emprise, ce qui laisse entendre que c’est le juge administratif qui est compétent de traiter ce différend.
En ce qui concerne les conclusions que Mr Landrin pourra présenter et élaborer devant le juge, on en trouve deux éléments :
1) Conclusions indemnitaires : Mr Landrin est pleinement en droit de revendiquer l’indemnisation des préjudices qu’il a endurés ; ainsi, il a la possibilité de responsabiliser l’administration en estimant que l’exécution de l’aménagement relève d’une faute de sa part.
2) Conclusions à fin d’injonction : Mr Landrin a réclamé la remise en état de son terrain qui, au départ était en friche avant d’être transformé en parking public et en espace vert par la commune. Sa requête implique la démolition d’ouvrages publics, ce qui doit être examiné à la lumière d’une jurisprudence rigide en matière de destruction d’ouvrages publics. A cet égard, il est nécessaire de consulter une décision du « Conseil d’Etat en 2019, Pinault, requête numéro 410689 » à propos du cadre juridique mis en exécution pour le règlement du litige, Cette décision montre que « lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général » * Dans cet avis, le conseil d’état précise que lorsqu’un ouvrage a été irrégulièrement installé, comme c’est le cas en l’espèce, le juge doit d’abord vérifier si la situation est susceptible d’être régularisée. En l’occurrence, cela semble impraticable car la remise en l’état suppose le retour du terrain en friche. Autrement dit, la régularisation n’est pas envisageable.
Si aucune régularisation n’est réalisable, le juge doit examiner si la démolition ne constitue pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Ce n’est qu’après avoir apprécié que cette démolition n’est point préjudiciable pour l’intérêt général que l’ouvrage pourra être anéanti.
Question 2 :
On doit noter que l’énoncé nous demande de nous situer fictivement à la date du 01/06/2023, ce qui correspond à presque 3 mois après la notification de la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Rappelons premièrement la règle d’opposabilité des délais de recours.
Pour contester une telle décision, une procédure de médiation préalable est indispensable comme stipulé par « L’article R 213-10 du Code de Justice Administrative ». Conformément à cet article, la décision de radiation doit inclure cette obligation de médiation. En l’absence de cette mention : le délai de recours contentieux ne prend pas effet à l’encontre de la décision litigieuse.
En l’espèce, cette mention de médiation préalable obligatoire ne figure pas sur la décision de radiation de Mr Landrin, donc le délai de recours contentieux ne courrait pas à l’encontre de cette décision. En l’occurrence, la jurisprudence « Czabaj de 2016 » est mise en œuvre. Cette jurisprudence prévoit un délai d’un an pour contester une décision individuelle défavorable. D’après l’énoncé, cette décision a été notifiée le 06/03/2023, ce qui implique que Mr Landrin dispose d’un an pour contester la décision en passant par une médiation. Ainsi, il était toujours dans les délais pour contester. Toutefois, il doit s’adresser d’abord au médiateur régional de pôle-emploi avant de se tourner vers le tribunal administratif. Sa demande n’était donc pas tardive.
Question 3 :
Premièrement, Il faut qualifier le type de convention qui est conclu entre la commune et l’association. D’après l’énoncé, cette convention prévoit la mise à disposition gracieuse de plusieurs terrains communaux et également une aide financière répartie sur 4 années (2023-2027). De quoi s’agit cette aide ? En vertu de l’article 9-1 du 12 avril 2000, « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. »* On en déduit que la convention dont il est question constitue bel et bien une subvention.
Deuxièmement, il faut préciser le type de recours à envisager contre cette convention. En vertu de l’avis du « Conseil d’Etat 29/05/2019 Société Royale Cinéma » : « les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. »* Cela veut dire que les recours liés à une subvention, notamment la décision d’octroi de cette subvention, ne peuvent être contestés que par le biais d’un recours en excès de pouvoir.
On est dans un recours classique d’excès de pouvoir. Par conséquent, Mr Landrin est supposé former un recours en excès de pouvoir.
Dernièrement, il faut savoir quel était l’intérêt pour agir dont Mr Landrin pouvait se prévaloir. On revient sur l’avis du Conseil d’Etat cité auparavant qui stipule que seulement « les bénéficiaires de la subvention » ou « des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir » peuvent contester « devant le juge de l’excès de pouvoir ». Comme Mr Landrin n’est pas le bénéficiaire, il est donc dans la catégorie « des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir ». Il lui convient de prouver au juge qu’il dispose d’un intérêt lui donnant « qualité à agir ».
Examinons à présent les arguments dont Mr Landrin se prévaut :
a) Le festival trouble considérablement l’ordre public : cet argument est complètement inefficace dans un recours dirigé contre une subvention pour une association. Si effectivement la tenue du festival porte atteinte à l’ordre public, il faudra attaquer la décision qui autorise l’organisation de ce festival.
b) Il s’acquitte rigoureusement de ses impôts et le montant de la subvention est excessif : la qualité de contribuable peut être invoquée dans un recours en excès de pouvoir contre une décision de la commune qui viendrait augmenter excessivement les dépenses communales.
En guise de conclusion, il faut conseiller Mr Landrin de se prévaloir de son statut de contribuable local pour prouver son intérêt pour agir.
Un coup de pouce additionnel sur les anciens sujets de CRFPA
- Erreurs communes à éviter lors de la préparation des examens du CRFPA
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit civil (sujet 2023)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit des affaires (sujet 2023)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de note de synthèse - Violences conjugales (sujet 2023)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit des affaires (sujet 2022)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit social (sujet 2022)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit pénal (sujet 2022)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit international et européen (sujet 2022)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit fiscal (sujet 2022)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit administratif (sujet 2022)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit civil (sujet 2022)