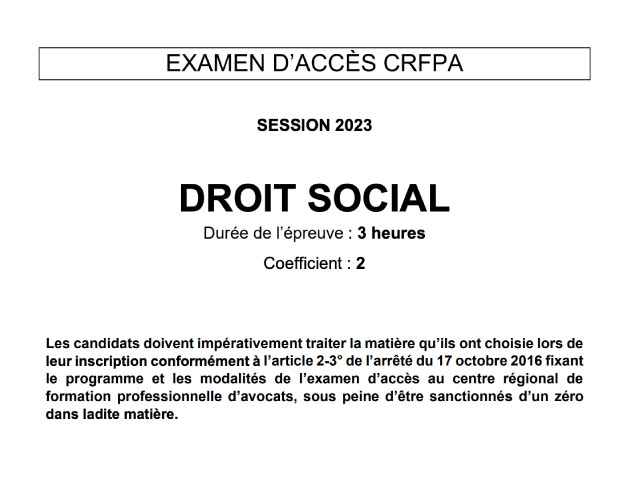Question I :
Afin de savoir si les revendications du cuisinier auraient des chances de succès ou pas, il faut se projeter sur deux points essentiels :
a) Le premier point est relatif à la contestation de la faute grave qui représente le fondement principal de ce licenciement.
b) Le second point concerne l’atteinte à la dignité du salarié.
a) La contestation de la faute grave qui représente le fondement principal de ce licenciement
En ce qui concerne la contestation de la faute grave, on doit d’abord préciser si les absences fréquentes au travail et les appels téléphoniques sans lien avec le travail constituent une faute grave. Pour cela, il sera judicieux de rappeler que la jurisprudence a clarifié que l’absence injustifiée d’un salarié pendant les heures de travail est considérée comme une faute grave qui peut être sanctionnée par un licenciement. Cette notion est illustrée à travers divers arrêts. A titre d’exemple, un arrêt de la Cour de cassation (Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.293) stipule que «La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est définie comme résultant d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié et constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis »* l’absentéisme injustifié constitue une violation des clauses du contrat et un manquement du salarié à ses obligations professionnelles.
En outre, ce manquement rend impossible la mise en exécution et le maintien du contrat de travail. Toutefois, il est nécessaire de rappeler que l’employeur doit être en mesure de fournir une preuve irréfutable avant de licencier le salarié. Comme l’indique l’article L1235-1 du code de travail « Si un doute subsiste, il profite au salarié. »* ce qui signifie que le doute éradique la légitimité du licenciement et agit en faveur du salarié afin de le protéger contre les procédures arbitraires. Par conséquent, la question qui se pose s’agit de savoir si les enregistrements de la caméra de surveillance sont des preuves recevables et valides devant un tribunal.
b) L’atteinte à la dignité du salarié
Quant à l’atteinte à la dignité, il est pertinent de rappeler le droit à la vie privée du salarié. Comme dit l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée »*. Il est également indispensable d’étaler ici l’arrêt « Nikon, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 2001 » qui met en évidence que : « Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance du contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ce, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur »*
- L'atteinte à la dignité humaine en droit du travail
- Le travail social et la protection de la vie privée
En d’autres termes, l’employeur est tenu de respecter la vie privée des salariés, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
Par ailleurs, l’article L2312-38 du code du travail affirme que « Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. »* Cela signifie que le CSE doit être informé et consulté en amont sur la mise en œuvre des techniques de contrôle des salariés. L’article L1222-4 est également pertinent et mérite d’être mentionné ; cet article stipule que « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. »*
On conclut que l’employeur qui installe un dispositif de surveillance est obligé d’informer préalablement les représentants du personnel ainsi que l’employé individuellement. De même, on peut faire usage de l’article L1121-1 afin d’évaluer la pertinence du dispositif installé pour surveiller le salarié. Cet article établit que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »*
Passons maintenant à la vérification de la validité de la preuve fournie par l’employeur. Conformément à l’arrêt « Manfrini, Cass. Soc. 25 novembre 2020 » : « l’illicéité d’un moyen de preuve, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats » cela signifie qu’une preuve illicite, voire attentatoire à la vie privée d’un individu, n’est pas forcément irrecevable.
La cour de cassation « 23 juin 2021, n° 19-13.856, FS-B » a validé la décision de la cour d'appel, qui a jugé les enregistrements de la caméra de surveillance inacceptables comme preuve contre le salarié. La raison en est que ces enregistrements ont été jugés intrusifs et disproportionné par rapport aux raisons de sécurité avancées par l'employeur. Il a été observé que le salarié, travaillant seul en cuisine, était constamment surveillé par la caméra. Ainsi, ce dispositif était totalement attentatoire à la vie privée du salarié et disproportionné au but poursuivi par l’employeur. Cette atteinte rendait donc la preuve irrecevable. Vu que le juge va considérer que la preuve de l’employeur est irrecevable, et que l’employeur ne dispose pas d’autres preuves moins attentatoires à la vie privée du cuisinier, le licenciement sera jugé comme « dépourvu de cause réelle et sérieuse ». Cela entraînerait plusieurs sanctions, notamment « une indemnité compensatrice de préavis », « une indemnité de congé payé sur préavis », « une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Il convient également de rappeler que le salarié a le droit de recevoir une réparation pour préjudice causé par le caractère vexatoire de son licenciement, à condition d’en apporter la preuve, et ce, indépendamment du bien-fondé de ce licenciement. En revanche, le seul fait d’une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié ne constitue pas une preuve solide de ce caractère vexatoire. Il est toutefois potentiel que le salarié ait subi une atteinte à sa vie privée sans que sa dignité soit affectée. Afin de renforcer ce point, La décision de la Cour de Cassation de 2022 juge que l’atteinte à la vie privée peut constituer un préjudice. Pour résumer, la présomption d’atteinte à la dignité par le salarié est infondée, il n’y a ici ni atteinte à la dignité ni preuve de caractère vexatoire manifestement exprimé dans ce licenciement.
Cependant, Il reste plausible que le salarié bénéficie d’une réparation de préjudice provoqué par l’atteinte à sa vie privée et non à sa dignité. Il appartient au juge d’évaluer le montant de cette réparation.
Question II :
La première question fondamentale qui se pose est la suivante : Les trajets d’un salarié entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients doivent-ils être inclus dans le temps de travail effectif et rémunérés en conséquence ?
En vertu de « l’arrêt Tyco » émis en 2015, si « les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du (temps de travail), au sens de cette directive, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites des premiers et derniers clients désignés par l’employeur »*
En l’espèce, Il s'agit d'un salarié itinérant dont les déplacements entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients doivent être pris en considération. Pendant ces trajets, le salarié ne pouvait manifestement pas se consacrer librement à des occupations personnelles, étant exhorté par l'employeur à interagir avec les clients.
Il est ainsi envisageable de considérer ces temps de déplacement comme du temps de travail effectif, susceptibles également d’être comptabilisées comme des heures supplémentaires.
La deuxième question à laquelle il faut répondre est la suivante : à qui incombe la responsabilité de prouver les heures de travail effectuées ?
Conformément à « l’Article L3171-4 »* du code de travail, il incombe à l'employeur d’apporter au juge les éléments justifiant les horaires réalisés par le salarié si un litige se produit concernant les heures de travail effectuées. En termes simples, la charge de la preuve des heures réalisées repose sur l’employeur. Ainsi, l’employeur s’exposera potentiellement à une demande importante de paiement de la part du salarié devant le juge et sera dans l’obligation de fournir des preuves démontrant la durée de travail du salarié.
La troisième question qui nous interpelle est la suivante : À partir de quelle date le salarié peut-il demander le paiement de ses heures de travail ?
Pour y répondre, il faut noter que la nouvelle jurisprudence de 2022 considère désormais que le temps de déplacement doit être considéré comme du temps de travail effectif et s'applique rétroactivement, englobant les périodes antérieures à l'embauche de Martial ALADUR. Ce dernier peut donc réclamer les avantages de cette nouvelle jurisprudence et demander des paiements pour des périodes antérieures à 2022, date du revirement. L’employeur pourrait toutefois tenter de restreindre le paiement aux trois dernières années, conformément aux règles du délai de prescription stipulé dans « l’Article L3245-1 du code de travail »*.
La quatrième question à traiter est la suivante : L'accident de circulation subi par Monsieur Aladur relève-t-il de la qualification d'accident de travail ?
En vertu de « l’Article L411-1 » du code de travail, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. »* Selon la présomption d’imputabilité, Si l'accident survient pendant le temps de travail, il est présumé être un accident de travail. Étant donné que Monsieur Aladur est un salarié itinérant, son accident de circulation pourrait être considéré comme un accident de travail si l'accident s’est produit pendant ses heures de travail et dans le cadre de ses fonctions professionnelles.
En vertu de « l’article L4121-1 du code du travail », l’employeur est obligé de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale de ses subordonnés.
Conformément à « l’article L452-1 du code de la sécurité sociale », l'employeur peut être tenu responsable pour une faute inexcusable si l’accident découle d’un manquement grave à l’obligation de sécurité. Si la faute inexcusable est confirmée, le salarié a le droit de jouir d’une réparation supplémentaire pour les dommages non couverts par la Sécurité Sociale. En l’espèce, vu que Mr Aladur a subi une sévère blessure corporelle qui l’a empêché de pratiquer du sport, il a la possibilité de demander une réparation pour le préjudice engendré par les fréquentes douleurs physiques et morales éprouvées et pour le préjudice d’agrément également.
Question III :
La question principale à laquelle on doit répondre dans ce cas est la suivante : Peut-on légalement punir une personne par une mise à pied pour avoir mis en pratique son droit d'alerte ?
Il faut d’abord préciser que la mise à pied disciplinaire implique l’existence d’une faute grave. Selon l’article « L1132-3 du travail », Personne ne peut être victime de discrimination pour avoir, en toute bonne foi, rapporté ou témoigné sur des actes criminels ou délictueux dont elle a eu connaissance en exerçant ses fonctions.
En se basant sur l’article précédent, on pourra affirmer que l'exercice du droit d'alerte ne peut pas être considéré comme une base légale pour justifier une mise à pied disciplinaire. Cette protection est assurée par la loi en faveur des délégués syndicaux, comme l’indique « l’article L2411-1 » du code du travail. En tant que déléguée syndicale, Agnès dispose du droit de lancer des alertes sans être exposée à des sanctions. Même pendant la mise à pied, elle devait aussi être en mesure d’accomplir ses missions de déléguée. Si le directeur l’a sanctionnée pour avoir fait son travail, cela demeure illégal et Agnès peut demander réparation au Conseil de Prud’hommes.
Un coup de pouce additionnel sur les anciens sujets de CRFPA
- Erreurs communes à éviter lors de la préparation des examens du CRFPA
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de Procédure civile (sujet 2023)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit administratif (sujet 2023)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit international et européen (sujet 2023)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit pénal (sujet 2023)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit fiscal (sujet 2023)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de Procédure administrative et contentieuse (sujet 2023)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit des obligations (sujet 2023)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit civil (sujet 2023)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit des affaires (sujet 2023)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de note de synthèse - Violences conjugales (sujet 2023)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit des affaires (sujet 2022)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit social (sujet 2022)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit pénal (sujet 2022)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit international et européen (sujet 2022)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit fiscal (sujet 2022)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit administratif (sujet 2022)
- CRFPA : Préparation à l'épreuve de droit civil (sujet 2022)