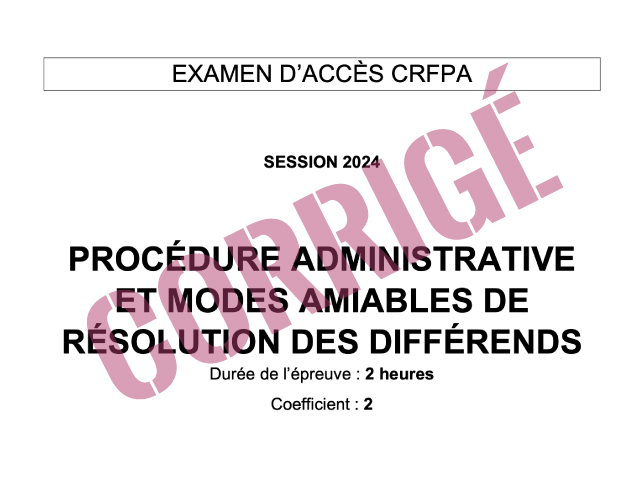Tous les sujets du CRFPA 2024 sont disponibles ici : https://www.objectif-barreau.fr/sujets-crfpa-2024
I. Le retrait des fonctions et responsabilités de M. Piteau
1) Sur la nature juridique des décisions
Aux termes de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative (CJA), « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ». Il en résulte que seules les décisions administratives produisant des effets juridiques suffisamment significatifs à l’égard de leurs destinataires peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Selon une jurisprudence constante, les mesures d’ordre intérieur — qui sont, par nature, insusceptibles de produire des effets notables — ne sont pas considérées comme des décisions faisant grief. Elles ne peuvent donc, en principe, faire l’objet d’un recours contentieux.
S’agissant plus particulièrement de la situation des agents publics, le Conseil d’État a précisé que seules sont susceptibles de recours les mesures qui, bien qu’ayant l’apparence de simples mesures d’organisation du service, portent atteinte aux droits et prérogatives statutaires de l’agent, affectent l’exercice de ses libertés fondamentales, entraînent une perte de responsabilités ou de rémunération, ou encore traduisent une discrimination. C’est dans ce sens que s’inscrit la décision de Section du 25 septembre 2015 (CE, Sect., Mme Bourjoly, n° 372624), désormais classique.
En l’espèce, les décisions contestées ont pour effet de retirer à M. Piteau, d’une part, la direction d’un centre de recherches, et d’autre part, la responsabilité de l’animation du service d’hématologie clinique. Elles ont donc pour conséquence directe de restreindre de manière significative l’étendue de ses fonctions et de ses attributions, tant au sein de l’Université que dans l’organisation du CHU. En ce qu’elles entraînent une perte de responsabilités, ces décisions doivent être regardées comme faisant grief.
Dès lors, et en application de la jurisprudence précitée, elles présentent le caractère de décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir. M. Piteau est donc recevable à en demander l’annulation devant la juridiction administrative.
2) Sur le délai de recours contentieux
a) Recevabilité du recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2023
L’article R. 421-1 du CJA fixe à deux mois le délai de recours contentieux à compter de la notification régulière d’une décision administrative individuelle. Toutefois, pour que ce délai puisse être valablement opposé au destinataire, l’article R. 421-5 du même code exige que la notification comporte, de manière claire, l’indication des voies et délais de recours.
À défaut, la décision ne peut pas faire courir le délai de deux mois. Néanmoins, le Conseil d’État, dans sa décision d’Assemblée Czabaj (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763), a posé une limite de principe à cette absence de délai opposable. Dans un souci de sécurité juridique, il a jugé qu’une décision individuelle ne saurait être contestée indéfiniment : un recours ne peut être introduit au-delà d’un délai raisonnable, généralement fixé à un an, sauf circonstances particulières invoquées par le requérant.
Appliquant ces principes à la présente situation, il apparaît que la décision datée du 3 novembre 2023 ne comportait pas les mentions obligatoires relatives aux voies et délais de recours. En conséquence, le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 CJA ne peut être utilement opposé à M. Piteau.
Il convient dès lors de se référer au seul délai raisonnable d’un an issu de la jurisprudence Czabaj. Dès lors que la décision a été notifiée, au plus tôt, le 3 novembre 2023, et que le recours est exercé à une date antérieure au 3 novembre 2024, ce délai d’un an n’est pas expiré à la date du 1er juin 2024.
Il en résulte que le recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2023 doit être regardé comme recevable.
b) Recevabilité du recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2024
La décision du 24 janvier 2024, par laquelle le directeur général du CHU de Grenoble a retiré à M. Piteau la responsabilité d’« animer » le service d’hématologie clinique, n’a pas fait l’objet d’une mention expresse quant à sa notification régulière. Aucune indication certaine ne permet de confirmer si cette décision a été notifiée avec les voies et délais de recours. L’absence de précision en ce sens, contrastant avec les mentions relatives à la décision du 3 novembre 2023 — dont il était expressément indiqué qu’elle avait été notifiée sans ces mentions — laisse présumer qu’elle l’a été régulièrement, mais cette information reste incertaine.
Deux hypothèses doivent dès lors être envisagées :
Si la décision a été régulièrement notifiée avec l’indication des voies et délais de recours, le délai contentieux de deux mois, qui est un délai franc, courait alors jusqu’au 25 mars 2024 (sous réserve que cette date ne corresponde pas à un samedi ou un dimanche).
Dans le cas contraire, si la notification a été irrégulière ou n’a pas eu lieu, le recours demeure possible dans le cadre du délai raisonnable d’un an posé par la jurisprudence Czabaj (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763), à compter de la notification effective ou de la date à laquelle il est établi que M. Piteau a eu connaissance de la décision.
Quelle que soit l’hypothèse retenue, il est constant que le recours gracieux formé par M. Piteau le 14 mars 2024 est intervenu avant l’expiration du délai applicable. Ce recours a donc été introduit dans les temps.
Depuis l’arrêt rendu par la section du contentieux le 13 mai 2024 (CE, Sect., Mme Caire-Tetauru, n° 466541), le Conseil d’État juge que, pour apprécier si un recours contentieux formé par voie postale a été introduit dans les délais, il convient de se référer à la date d’expédition, le cachet de la poste faisant foi. Bien que cette décision vise les recours contentieux, on peut légitimement penser que cette solution est transposable aux recours administratifs, le Conseil d’État les ayant traditionnellement soumis au même régime de computation.
Ainsi, le recours gracieux du 14 mars 2024 doit être regardé comme ayant été formé dans le délai de recours contentieux, ce qui a pour effet d’interrompre le cours du délai, conformément à l’article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Il est désormais acquis que cette disposition s’applique également lorsqu’il s’agit d’un délai raisonnable de recours (CE, avis, 12 juillet 2023, Metaoui, n° 474865).
Il est par ailleurs précisé que, s’agissant d’un agent public, M. Piteau ne peut utilement se prévaloir des articles L. 112-3 et R. 112-5 du CRPA, qui imposent à l’administration de délivrer un accusé de réception précisant les délais et voies de recours. En effet, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer aux agents publics dans ce contexte (v. CE, 15 mai 2023, n° 463055).
En l’absence de réponse expresse du CHU, le recours gracieux est réputé implicitement rejeté au terme d’un délai de deux mois non franc, conformément à l’article L. 231-4 du CRPA. Si l’on retient la date d’envoi du recours gracieux au 14 mars 2024, la décision implicite de rejet est intervenue le 14 mai 2024.
Cette décision implicite peut, à son tour, faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai franc de deux mois, expirant donc le 15 juillet 2024.
Par conséquent, au 1er juin 2024, ce second délai de recours n’est manifestement pas expiré. La décision du 24 janvier 2024 peut donc, elle aussi, faire l’objet d’un recours contentieux recevable devant la juridiction administrative.
II. Le remplacement de M. Piteau
1) Sur l’intérêt pour agir de M. Piteau
Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire peut contester toute décision portant atteinte aux droits qu’il tient de son statut, ou aux prérogatives liées aux fonctions qu’il occupe. Cette solution est consacrée de longue date, notamment par l’arrêt Lot (CE, 11 décembre 1903, n° 10211, GAJA).
En l’espèce, les statuts de l’Université réservent la direction des centres de recherche aux professeurs des universités – praticiens hospitaliers (PU-PH). Or, le successeur désigné de M. Piteau, M. Aucoc, n’a pas cette qualité. La décision de nomination opérée en sa faveur contrevient donc aux règles statutaires applicables et constitue, de ce fait, une atteinte aux prérogatives attachées aux fonctions exercées par les PU-PH.
Cette désignation remet ainsi en cause non seulement les intérêts individuels de M. Piteau en tant qu’agent ayant précédemment exercé ces responsabilités, mais aussi les droits collectifs afférents à sa qualité de PU-PH.
Il justifie donc, à double titre, d’un intérêt pour agir suffisant pour introduire un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision.
2) Sur l’intérêt pour agir du syndicat
L’intérêt à agir des groupements, et notamment des syndicats, a été reconnu dès l’arrêt Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges (CE, 28 décembre 1906, n° 25521, GAJA). Toutefois, leur capacité à introduire un recours est subordonnée à la condition que la décision contestée porte atteinte à un intérêt collectif qu’ils ont vocation à défendre.
En principe, les syndicats n’ont pas qualité pour contester des décisions purement individuelles. Cependant, cette règle connaît une exception : lorsqu’une décision individuelle favorable à un agent porte atteinte aux intérêts collectifs d’une catégorie d’agents, le syndicat peut agir. Cela a été jugé notamment en matière de nomination, dans l’arrêt Syndicat CGT des employés de la mairie de Nîmes (CE, Sect., 13 décembre 1991, n° 74154).
En l’espèce, la nomination de M. Aucoc — qui n’est pas PU-PH — à un poste normalement réservé à cette catégorie statutaire, constitue une entorse aux garanties collectives reconnues aux PU-PH. Ce faisant, elle lèse l’intérêt collectif que le syndicat « Défense – PU-PH » a précisément pour mission de protéger.
Dès lors, ce syndicat est fondé à agir en excès de pouvoir contre la décision contestée, au même titre que M. Piteau.
III. Les retenues sur le traitement de M. Piteau
1) Sur la nature des recours contentieux
a) La lettre du 22 avril 2024
Le 22 avril 2024, M. Piteau a été informé par le directeur général du CHU de Grenoble que des retenues seraient opérées sur son traitement pour absence de service fait au mois de mai 2024.
Il s’agit d’une décision à objet pécuniaire, mais sa contestation ne relève pas automatiquement du plein contentieux. En effet, selon l’avis du Conseil d’État du 25 mai 2023 (n° 471035, La Poste), la qualification du recours dépend à la fois de l’objet de la décision et de la nature des conclusions du requérant. Une lettre annonçant une retenue sur traitement, qui ne précise pas le montant réclamé, et émanant d’un employeur public — même doté d’un comptable public — ne peut être assimilée à un titre exécutoire.
Elle conserve alors la nature d’un acte administratif unilatéral susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, dès lors que le requérant sollicite son annulation et non la restitution d’une somme déterminée.
En l’espèce, bien que l’université soit un établissement public doté d’un comptable, l’absence de mention du montant exact de la retenue conduit à qualifier le recours formé contre cette lettre de recours pour excès de pouvoir.
b) Le titre de perception notifié le 25 mai 2024
Le second acte contesté est un titre exécutoire émis par l’administration pour le recouvrement de la somme correspondant aux retenues sur traitement.
Dans ce cas, le contentieux relève du plein contentieux. En effet, le juge administratif est alors saisi d’un litige pécuniaire portant sur l’existence, le montant ou la validité de la créance, et peut prononcer, s’il y a lieu, la décharge partielle ou totale de l’obligation de payer (CE, Sect., 27 avril 1988, n° 74319, Mbakam).
Le recours introduit à l’encontre de ce titre de recettes s’analyse donc comme un recours de pleine juridiction.
2) Sur l’obligation du ministère d’avocat
L’article R. 431-2 du Code de justice administrative prévoit que le ministère d’avocat est obligatoire devant le tribunal administratif dans les litiges tendant au paiement d’une somme d’argent, ou à la réduction ou décharge d’une créance.
Cependant, cette obligation connaît deux exceptions prévues par l’article R. 431-3 CJA :
Le ministère d’avocat n’est pas requis dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, même dirigé contre une décision à caractère pécuniaire. Cette solution a été consacrée par la jurisprudence Lafage, qui admet un tel recours sans avocat dès lors que le requérant se borne à demander l’annulation de l’acte.
L’avocat n’est pas non plus obligatoire pour les litiges individuels relatifs à la situation des fonctionnaires, même si ces litiges comportent une dimension financière (R. 431-3, 3° CJA).
En l’espèce, le recours contre la lettre du 22 avril 2024, de nature excès de pouvoir, entre dans le champ de cette exception. Le recours contre le titre exécutoire du 25 mai 2024, bien que relevant du plein contentieux, porte sur un litige individuel concernant un agent public.
Dans les deux cas, le ministère d’avocat n’est donc pas requis pour saisir le tribunal administratif.