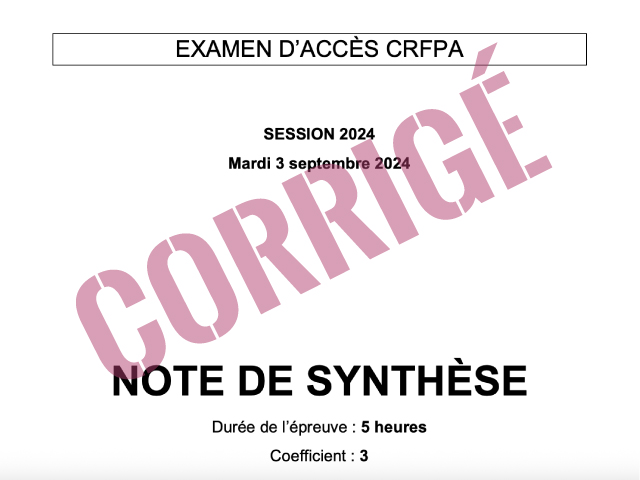Sujet disponible ici : cnb.avocat.fr
- Note de synthèse - CRFPA - réalisée dans le cadre d'entraînement
- Méthodologie de la note de synthèse pour le CRFPA
Le 28 novembre 2017, Emmanuel Macron souhaitait que « d’ici à cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Africain » (document 14). Cette déclaration du Président est révélatrice de la variété de la restitution qui va au-delà des seuls rapports individuels de droit privé.
La restitution qui a lien « en nature ou lorsque cela est impossible, en valeur » en vertu du Code civil (document 2) est non seulement variée mais également actuelle. En effet, des projets, proposition de la loi, proposition de résolution et promesse viennent s’ajouter ces dernières années aux textes et états de la jurisprudence en la matière.
La restitution est encadrée par le droit positif (I), et est la conséquence de certains comportements (II).
I - L’encadrement de la restitution
Si la restitution est reconnue en droit positif (A), sa mise en œuvre est toutefois conditionnée par la jurisprudence (B).
A - Une reconnaissance positive
La restitution est reconnue en droit positif. Elle est régie par le Code civil en son chapitre V. Elle a lieu en principe, en nature (document 2). Ainsi, il est jugé que les parts sociales composant le capital d’une société en liquidation judiciaire ont toujours une existence propre et peuvent faire l’objet d’une restitution en nature (document 4).
Est également consacrée l’obligation pour une personne de restituer ce qu’il a indument reçu (document 15). Aussi, le Code civil permet au possesseur « de faire les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi » (document 16). La restitution obéit par ailleurs à un formalisme particulier, régi par le Code des procédures civiles d’exécution (document 13).
En droit pénal, le procureur de la République peut demander à l’auteur des faits une réparation du dommage, notamment au moyen d’une restitution (document 7).
En droit commercial, la partie victime de certaines pratiques énumérées dans le Code de commerce peut demander la restitution des avantages indus (document 9).
B - Une mise en œuvre de la restitution
Les conditions de mises en œuvre de la restitution sont appliquées par la jurisprudence. D’abord, la jurisprudence retient que sauf l’hypothèse où la sous-location a été acceptée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le locataire sont des fruits civils (document 12).
Aussi, le joyau d’une fiancée peut être restituée à celui qui le transmet lorsque le joyau a appartenu à ses ascendants ou collatéraux, ou quand une grande valeur eu égard aux ressources du soupirant (document 17).
Ensuite, si l’annulation d’une cession de parts donne lieu à une restitution en valeur, cette circonstance n’empêche pas une restitution au cédant des fruits découlant des parts sociales sous réserve d’une perception en connaissance de l’illégalité entachant l’acte faisant l’objet d’une annulation par celui qui est tenu à la restitution (document 10).
En droit pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière (document 6).
II - Les fondements de la restitution
La restitution permet de sanctionner l’atteinte à la personne humaine (A), mais aussi les biens mal acquis ou spoliés (B).
A - L’atteinte à la personne humaine
Le Code civil disposant que « le respect du corps humain ne cesse avec la mort », s’est posée la question de la restitution à leur pays d’origine des restes humains appartenant aux collections publiques. Ainsi, une proposition de loi encadrant la restitution des restes humains a été déposée au Sénat le 26 avril 2023 (document 1).
L’atteinte à la dignité humaine est susceptible de déroger au principe d’inaliénabilité consacré au travers du Code général des collectivités territoriales, en permettant la sortie de biens du domaine public, que ce soit les restes humains appartenant aux collections publiques ou les biens culturels ayant fait l’objet de spoliations lors de persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 (documents 1 et 5). Pour ces dernières, le Conseil d’État considère que leur « restitution s’impose au nom de l’intérêt général supérieur » (document 5).
Le principe d’intégrité du corps humain a également conduit le juge judiciaire sur le fondement de la cause immorale ou illicite, à condamner la restitution d’un lambeau de peau portant un tatouage et qui serait vendu « au prix d’un Picasso » (document 18).
B - Les biens mal acquis ou spoliés
Les biens « mal acquis » renvoient aux biens saisis par la justice et dont la propriété a été acquise avec de l’argent issu de détournements de fonds publics » et de la « corruption ». Elles font l’objet d’une législation depuis 2022 en vertu de laquelle des biens mal acquis sont vendus et les recettes liées à la vente de ces biens sont restituées à l’État d’origine des fonds sous la forme de programmes d’aide au développement (document 3).
Ces actions pourraient concerner les biens mal acquis des Bongo en France, mais aussi les biens mal acquis résultant de crimes de corruption et de blanchiment d’argent et impliquant des ressortissants et es responsables libanais (documents 3 et 11).
Outre les biens acquis, la restitution intéresse également les biens spoliés. Ainsi, en va-t-il des biens du patrimoine culturel subsaharien dont la quasi-totalité se trouve hors du continent africain ; selon la recherche, ces biens « relèvent d’une spoliation en raison des rapports inégaux entre les parties, et préconisent leur restitution » (document 14). Aussi, les biens ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrés entre 1933 et 1945 font l’objet d’un projet de loi concernant leur restitution (document 5).